📘Livre « L’entreprise performante » - Publié en 1985 - Extraits choisis (1)
Il y a quelques semaines, je suis tombée par hasard sur un livre dont le titre m’a interpellée « L’entreprise performante ». 📖
Il s’agit d’un vieux livre. Un livre datant de 1985. 40 ans ! On y parle encore de Francs. 😉
Entre le titre et la 4ème page de couverture, ma curiosité a été piquée.
Je me suis plongée dans la lecture de ce livre avec un objectif : savoir quelles étaient les caractéristiques d’une entreprise performante il y a 40 ans.
Et surprise ! Les bonnes pratiques identifiées en ce temps lointain sont les mêmes qu’aujourd’hui. 🤨
J’ai donc décidé de vous partager quelques extraits de ce livre. Je les ai choisis car en résonance avec mon quotidien. 40 ans après sa publication, les critères de performance que je vous présente sont toujours d’actualité, connus mais trop peu mis en œuvre.
Pour ce 1er article de partage sur ce livre, je souhaite vous parler d’innovation.
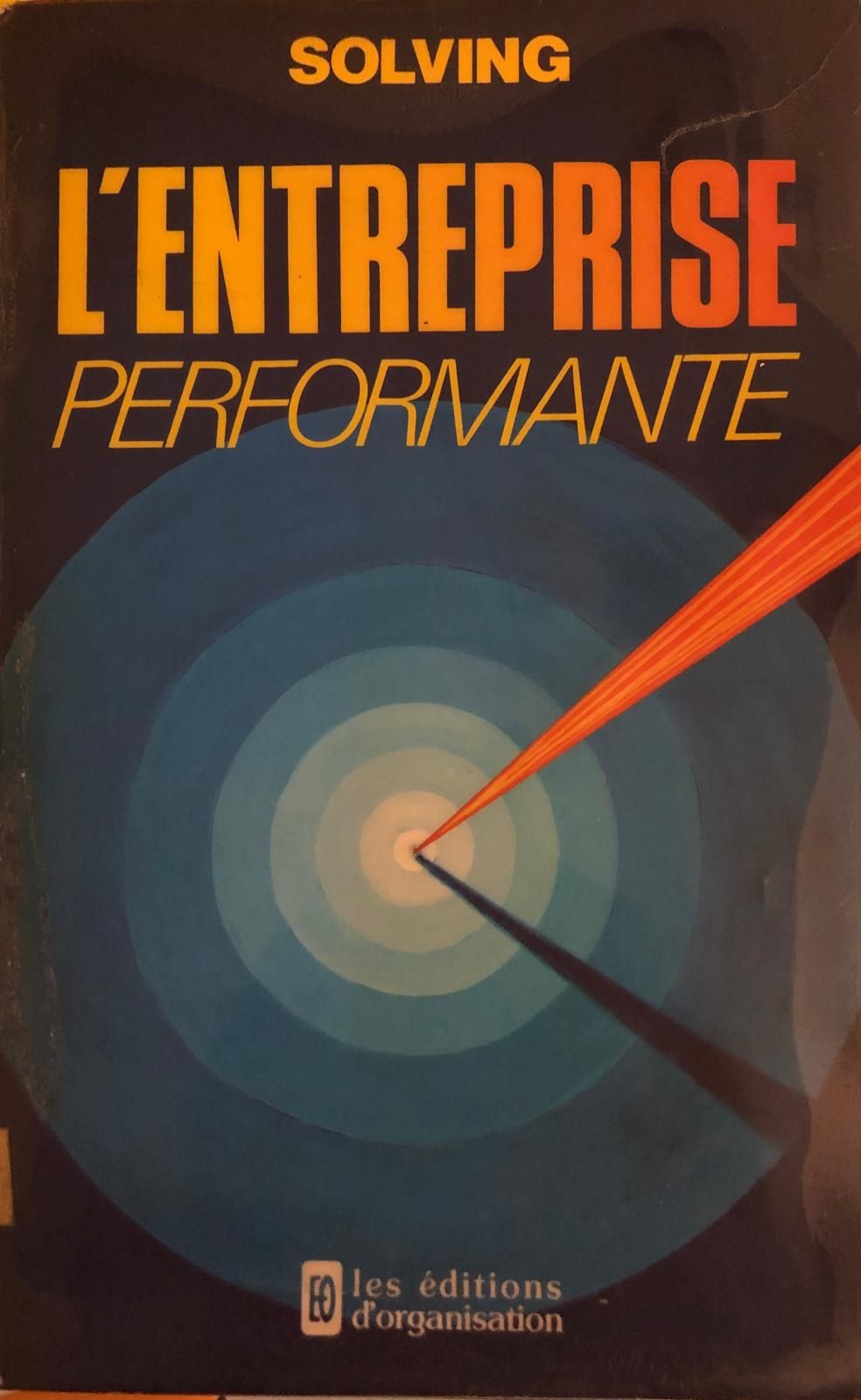
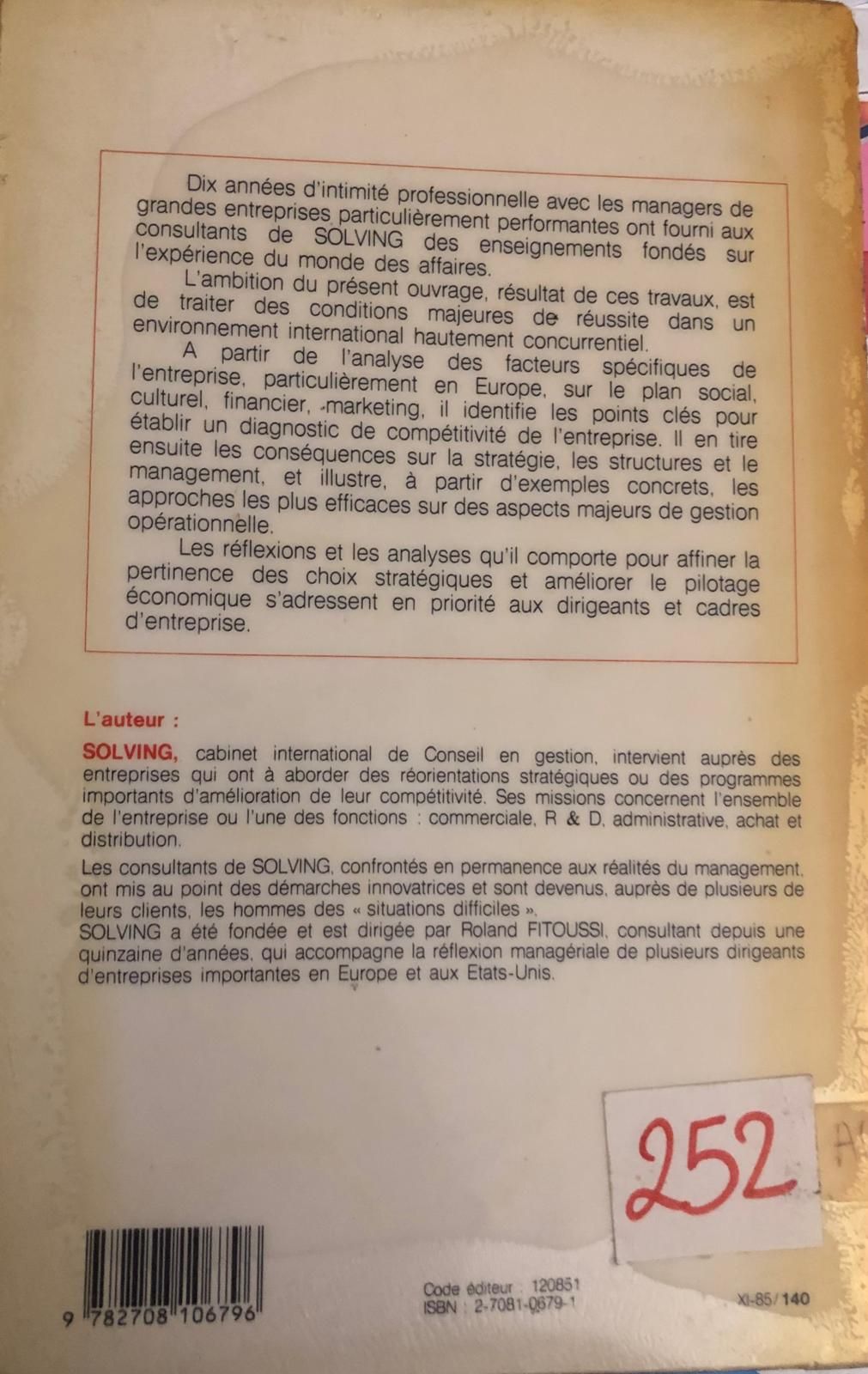
Développement et Innovation
Qui dit entreprise performante dit entreprise capable de résoudre ses problématiques, d’innover et de se réinventer.
Quelles sont donc les questions clés à se poser pour s’assurer de l’efficacité de son entreprise à survivre et se développer ?
« Mon implication personnelle de dirigeant est-elle suffisante sur ces problèmes ? »
L’efficacité des fonctions liées à l’innovation trouve sa source au niveau de la Direction générale de l’entreprise.
Pour les auteurs du livre, les entreprises performantes innovent, quels que soient leur taille ou contexte. Elles présentent toujours les caractéristiques suivantes :
- Elles savent provoquer une mobilisation de l’ensemble des collaborateurs et ce de l’idée à la mise en œuvre.
- Elles trouvent des ressources d’idées, d’informations, de compétences et de financement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.
- Elles ont mis en place des structures porteuses d’innovations, valorisant les idées et supprimant les blocages dans les processus de mise en œuvre.
Indiquer les objectifs, allouer des ressources, mettre en place des structures organisationnelles sont des tâches de la Direction générale.
Un projet de développement, d’innovation, est un projet du directeur général.
« Qui fait de la recherche ? Qui fait du développement ? »
Il faut considérer de façon distincte les problèmes de la recherche et ceux du développement.
Innover rime avec création de projets. Projets de recherche et/ou projets de développement. Pour les auteurs du livre, il est important de différencier les 2 sous peine d’inefficacité.
La recherche s’inscrit dans le long terme pour ouvrir le champ des possibilités. On sait que l’on recherche mais on ne sait pas ce que l’on trouvera. La recherche est un processus d’augmentation des connaissances dont les résultats seront utilisés pour des développements de produits ou de procédés nouveaux, différents.
Le développement s’inscrit souvent dans le plus court terme avec une planification. On travaille sur un objectif de satisfaction d’un besoin du marché ou de production (produit ou procédé).
« Notre formulation stratégique est-elle suffisante et compréhensible pour nos équipes ? »
Une formulation claire du besoin stratégique d’innovation est une condition essentielle de motivation et de réussite.
Rappelez-vous, pour les auteurs du livre, l’efficacité d’une entreprise part de sa direction.
Les entreprises qui réussissent à innover dans leur produits ou processus y sont poussés par un besoin identifié (besoin de diversification, nécessité de renouvellement de produit/service, risque d’obsolescence technologique, amélioration des coûts de production…).
La formulation de ce besoin et sa compréhension par les équipes sont une source d’efficacité. Et peu importe que l’ambition initiale provienne d’une analyse méthodique et rationnelle ou d’une « intuition » de la Direction générale.
« Nos ressources sont-elles correctement allouées ? »
Toute entreprise, même de petite taille, doit dégager des moyens pour développer et innover.
C’est une évidence mais cela vaut la peine de le rappeler.
Les auteurs précisent que ces moyens sont à définir en tenant compte :
- De l’horizon (court terme, long terme)
- De l’objectif
- Des ressources humaines et financières disponibles dans l’entreprise
- Des délais et des coûts nécessaires.
« Nos ambitions sont-elles cohérentes avec le niveau d’évolution de l’entreprise ? »
Tenir compte du métier et des idées dominantes de l’entreprise.
Le type d’activité de l’entreprise, son niveau actuel de connaissances, les idées dominantes dans l’entreprise, son historique … tout cela conditionne très fortement le choix des ambitions mais également l’organisation à mettre en place pour les projets d’innovation choisis.
« Les bons profils d’homme et de femmes sont-ils à la bonne place ? »
Assurer l’équilibre des fonctions critiques.
Les auteurs indiquent que « les études les plus récentes » (rappel, nous sommes en 1985) montrent que disposer dans son organisation des compétences et expertises « techniques » ne suffit pas à garantir le succès de ses projets. L’efficacité d’une structure à résoudre ses problèmes repose en grande partie sur un certain nombre de fonctions critiques indispensables. Chacune de ces fonctions correspond à un profil d’hommes et de femmes particulier.
Pour les auteurs les types de profils indispensables dans une organisation sont :
- Générateurs d’idée (variété de solutions, d’opportunités)
- Animateurs de projet (coordinateurs transversaux)
- Entrepreneurs
- « Sponsor » (appui hiérarchique)
- Gestionnaires de projets (administration, contrôle)
- « Gate keeper » (« guetteur » d’informations)
- Conservateurs (gardiens de la tradition, ils évitent les dérives trop importantes).
Les auteurs alertent, de plus, sur le fait qu’une position hiérarchique inadaptée de ces divers profils dans la structure peut diminuer leur valeur individuelle.
Une organisation doit donc s’adapter, définir le nombre, la répartition, la position hiérarchique … de ces différents profils afin d’aboutir à l’efficacité de chacun individuellement et collectivement.
« Les « citadelles » ne pénalisent elles pas la prise en charge du développement ? »
L’équilibre entre les fonctions opérationnelles dans la structure doit être adapté aux objectifs de développement.
L’histoire de chaque entreprise suffit en général à expliquer un certain équilibre entre les fonctions opérationnelles de l’organisation.
Exemples :
- Prédominance des ventes et du marketing dans une entreprise de biens de consommation
- Prédominance du bureau d’études dans une entreprise à technologie de pointe …
Tout comme les marchés, les positions respectives des entreprises évoluent dans le temps, le succès des projets passe par une adéquation de la structure organisationnelle aux nouveaux objectifs de développement de l’entreprise.
Exemples :
- La fonction commerciale est-elle suffisamment influente lors de la définition et le développement de nouveaux produits ?
- Les responsables de la production savent-ils formuler des demandes d’amélioration ? Comment formulent ils leurs contraintes de productivité ?
Selon les objectifs et les atouts stratégiques, l’équilibre entre les fonctions opérationnelles devra, peut-être, être modifié et la structure de l’entreprise repensée.
« La structure est-elle cloisonnée ? »
Supprimer les cloisonnements. Faciliter les articulations clés.
Pour les auteurs, les cloisonnements dans l’organisation sont la 1ère cause d’inefficacité des fonctions liées au développement de nouveaux produits ou services.
Même dans les entreprises où l’objectif stratégique est bien défini, un cloisonnement structurel peut empêcher que cet objectif soit perçu par les responsables des échelons inférieurs. Le manque de communication entre 2 structures est fréquent.
De plus, dans une même structure, des cloisonnements interdisciplinaires sont fréquemment observés. Les causes en sont nombreuses :
- Profil des collaborateurs (âges, compétences, expertises …)
- Citadelles « historiques » dans l’entreprise
- Eloignement géographique
- Procédures inadaptées à la structure ou au type de technologie
- Manque d’animation, contrôle transverse projet…
Les auteurs indiquent qu’il faut bien identifier les articulations nécessaires, qu’elles soient générales ou spécifiques à l’entreprise.
Pour plus de performance, la structure, l’évolution des carrières, les procédures et processus de travail devront principalement viser la suppression des cloisonnements (créer des affinités, des points de concertation, des complicités positives…).
« Le formalisme de nos procédures est-il excessif ou insuffisant ? »
Les structures de l’entreprise doivent favoriser la créativité et l’intervention de compétences et de motivations multiples. Cette diversité doit être compensée par des procédures parfaitement au point.
Les auteurs du livre rappellent que des études (on est toujours en 1985) ont montré que le taux de succès des projets tient plus du niveau de motivation et de la qualité de formulation de l’objectif que de la rigueur de la planification ou du contrôle.
De leur point de vue, des procédures inadaptées peuvent renforcer les cloisonnements et pénaliser l’efficacité des projets.
Il faut donc que les procédures obéissent à quelques principes généraux simples et clairs pour l’allocation des ressources, l’animation et le contrôle des projets. Leur formalisme détaillé doit pouvoir être adapté à chaque cas, contexte.
Les procédures doivent être réalistes, viser l’amélioration et non la perfection. Elles ne peuvent pas être suffisantes pour régler à elles seules tous les problèmes de mise en œuvre.
Les auteurs précisent que les rééquilibrages structurels sont prioritaires par rapport aux procédures. La Direction générale doit reconnaitre que l’efficacité des projets ne dépend pas uniquement des équipes opérationnelles et qu’ils doivent exercer une pression suffisante sur la structure.
A suivre
Les autres thématiques que je souhaite partager dans les prochains articles concernant ce livre :
- L’animation et la communication
- Caractéristiques d'une culture d'entreprise performante
- Les incohérences de structure, d’organisation
- Les décisions de qualité.